****
Vous êtes une icône américaine. Êtes-vous conscient de ce statut et vous importe-t-il ?
Je ne sais pas trop quel est exactement mon statut, mon image, je n'ai jamais eu de certitudes là-dessus. Quand on se met à vendre énormément de disques, on sait qu'on est populaire, mais à part ça... En fait, je ne réfléchis pas en termes de statut, je ne pense pas créer quelque chose d'extraordinaire, je me contente de continuer de faire mon boulot. Je me suis toujours vu comme un Américain typique. Comme beaucoup de mes concitoyens, j'ai grandi dans une petite ville provinciale, j'ai des origines très diverses irlandaises, italiennes, néerlandaises... Et j'ai toujours écrit depuis ce point de vue-là, celui d'un Américain moyen. Les vies et les sentiments décrits dans mes chansons sont ordinaires. J'ai toujours pensé que si je chroniquais cette expérience commune de la vie, beaucoup de gens s'y reconnaîtraient. Et avec un peu de chance, mes chansons illumineraient leur existence parce qu'elles rendraient justice à un certain sens de la dignité, à une forme d'héroïsme quotidien que l'on néglige trop souvent. La lutte permanente des gens ordinaires pour gagner leur croûte, avoir un toit, élever leurs enfants, trimer tous les jours dans un boulot que l'on n'aime pas, payer des factures médicales astronomiques mais nécessaires, etc. : tout cela relève d'une forme d'héroïsme très peu célébrée. C'était l'existence quotidienne de ma famille, c'est celle de nombre de mes amis... Voilà, je voulais chroniquer cette expérience-là parce que la musique populaire ne le faisait pas assez souvent.
Vos premiers héros étaient Dylan, Presley, Roy Orbison : vous expliquez bien comment, dans un foyer sans livres et sans culture, leurs chansons entendues à la radio vous ont ouvert au monde. Sont-ils toujours aussi importants pour vous aujourd'hui ?
Quand des artistes ont ce genre d'impact sur vous, ils restent en vous à jamais. Il se peut que vous n'écoutiez pas leurs disques pendant des années, mais ils font quasiment partie de vos gènes. Vous devez à ce genre de personnes une dette éternelle, parce qu'ils ont été les premiers à vous ouvrir des portes, des portes émotionnelles qui vous ont aidé à savoir qui vous êtes, qui vous ont aidé à vous construire et à faire le point dans votre vie. Ces héros-là ne vous quittent jamais. Je n'ai pas écouté de disque de Dylan ou d'Elvis depuis un moment, mais je sais que je peux être inspiré par eux à tout moment. Tout le monde, à chaque génération, peut citer un disque qui a bouleversé sa vie : ça peut être les Sex Pistols, Nirvana, un disque de rap...
Justement, est-ce que de nouveaux artistes, dans les années récentes, ont eu sur vous le même impact que Presley ou Dylan ?
Non, mais je crois que c'est lié à l'adolescence, cette période de découverte, d'éveil des sens, de construction d'identité... Une fois qu'on a passé cette période, je ne pense pas qu'une musique, quelle qu'elle soit, puisse produire un effet aussi intense, aussi puissant que pendant ces années de formation. Je connais un tas de gens qui aiment la musique qu'ils écoutaient au lycée pour le restant de leur vie. Moi, en vieillissant, j'essaie de garder mes oreilles ouvertes pour toute bonne musique, d'où qu'elle vienne et quel que soit son style. Je trouve que Kurt Cobain était un artiste d'une immense envergure ; j'ai beaucoup aimé le single Gangsta Paradise de Coolio, c'était un bel exemple de spiritual contemporain... Ces exemples pour dire qu'il y a toujours de la musique passionnante qui sort, que certains nouveaux disques me font toujours de l'effet. Évidemment, je ne vais plus chez le disquaire chaque semaine comme lorsque j'étais gamin. Et puis maintenant, j'ai plein de lieux d'influence en dehors de la musique : les films, les romans, les journaux...
Aujourd'hui, je me nourris d'un tas de sources variées, même musicalement : j'ai enregistré un disque un peu expérimental qui n'est jamais sorti , avec plein de petits beats différents, des essais soniques, un truc pas, mal mais jamais terminé. Je suis toujours en état réceptif, je guette la beauté, d'où qu'elle vienne. Récemment, j'ai assisté pour la première fois à une représentation de Don Giovanni : une expérience fabuleuse. Je ne connais pas grand-chose à la musique classique, mais on venait de jouer à Vienne et l'atmosphère de la ville m'en a donné envie. J'ai tout de suite désiré un cours de rattrapage express (rires)... Le monde est tellement riche de beautés diverses, vous avez envie d'en capturer le maximum, vous ne voulez pas que ça vous passe sous le nez. Mais je me débrouille bien (rires)...
Je ne sais pas trop quel est exactement mon statut, mon image, je n'ai jamais eu de certitudes là-dessus. Quand on se met à vendre énormément de disques, on sait qu'on est populaire, mais à part ça... En fait, je ne réfléchis pas en termes de statut, je ne pense pas créer quelque chose d'extraordinaire, je me contente de continuer de faire mon boulot. Je me suis toujours vu comme un Américain typique. Comme beaucoup de mes concitoyens, j'ai grandi dans une petite ville provinciale, j'ai des origines très diverses irlandaises, italiennes, néerlandaises... Et j'ai toujours écrit depuis ce point de vue-là, celui d'un Américain moyen. Les vies et les sentiments décrits dans mes chansons sont ordinaires. J'ai toujours pensé que si je chroniquais cette expérience commune de la vie, beaucoup de gens s'y reconnaîtraient. Et avec un peu de chance, mes chansons illumineraient leur existence parce qu'elles rendraient justice à un certain sens de la dignité, à une forme d'héroïsme quotidien que l'on néglige trop souvent. La lutte permanente des gens ordinaires pour gagner leur croûte, avoir un toit, élever leurs enfants, trimer tous les jours dans un boulot que l'on n'aime pas, payer des factures médicales astronomiques mais nécessaires, etc. : tout cela relève d'une forme d'héroïsme très peu célébrée. C'était l'existence quotidienne de ma famille, c'est celle de nombre de mes amis... Voilà, je voulais chroniquer cette expérience-là parce que la musique populaire ne le faisait pas assez souvent.
Vos premiers héros étaient Dylan, Presley, Roy Orbison : vous expliquez bien comment, dans un foyer sans livres et sans culture, leurs chansons entendues à la radio vous ont ouvert au monde. Sont-ils toujours aussi importants pour vous aujourd'hui ?
Quand des artistes ont ce genre d'impact sur vous, ils restent en vous à jamais. Il se peut que vous n'écoutiez pas leurs disques pendant des années, mais ils font quasiment partie de vos gènes. Vous devez à ce genre de personnes une dette éternelle, parce qu'ils ont été les premiers à vous ouvrir des portes, des portes émotionnelles qui vous ont aidé à savoir qui vous êtes, qui vous ont aidé à vous construire et à faire le point dans votre vie. Ces héros-là ne vous quittent jamais. Je n'ai pas écouté de disque de Dylan ou d'Elvis depuis un moment, mais je sais que je peux être inspiré par eux à tout moment. Tout le monde, à chaque génération, peut citer un disque qui a bouleversé sa vie : ça peut être les Sex Pistols, Nirvana, un disque de rap...
Justement, est-ce que de nouveaux artistes, dans les années récentes, ont eu sur vous le même impact que Presley ou Dylan ?
Non, mais je crois que c'est lié à l'adolescence, cette période de découverte, d'éveil des sens, de construction d'identité... Une fois qu'on a passé cette période, je ne pense pas qu'une musique, quelle qu'elle soit, puisse produire un effet aussi intense, aussi puissant que pendant ces années de formation. Je connais un tas de gens qui aiment la musique qu'ils écoutaient au lycée pour le restant de leur vie. Moi, en vieillissant, j'essaie de garder mes oreilles ouvertes pour toute bonne musique, d'où qu'elle vienne et quel que soit son style. Je trouve que Kurt Cobain était un artiste d'une immense envergure ; j'ai beaucoup aimé le single Gangsta Paradise de Coolio, c'était un bel exemple de spiritual contemporain... Ces exemples pour dire qu'il y a toujours de la musique passionnante qui sort, que certains nouveaux disques me font toujours de l'effet. Évidemment, je ne vais plus chez le disquaire chaque semaine comme lorsque j'étais gamin. Et puis maintenant, j'ai plein de lieux d'influence en dehors de la musique : les films, les romans, les journaux...
Aujourd'hui, je me nourris d'un tas de sources variées, même musicalement : j'ai enregistré un disque un peu expérimental qui n'est jamais sorti , avec plein de petits beats différents, des essais soniques, un truc pas, mal mais jamais terminé. Je suis toujours en état réceptif, je guette la beauté, d'où qu'elle vienne. Récemment, j'ai assisté pour la première fois à une représentation de Don Giovanni : une expérience fabuleuse. Je ne connais pas grand-chose à la musique classique, mais on venait de jouer à Vienne et l'atmosphère de la ville m'en a donné envie. J'ai tout de suite désiré un cours de rattrapage express (rires)... Le monde est tellement riche de beautés diverses, vous avez envie d'en capturer le maximum, vous ne voulez pas que ça vous passe sous le nez. Mais je me débrouille bien (rires)...
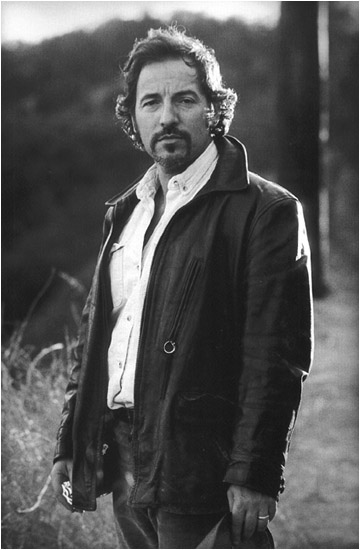
The Ghost of Tom Joad est largement inspiré par Les Raisins de la colère de John Ford. Adolescent, étiez-vous déjà un lecteur de romans et un cinéphile, ou bien ces passions sont-elles plus récentes ?
Quand j'étais gamin, j'allais aux séances du samedi après-midi. La plupart du temps, on passait des monster movies pour 35 cents... Pendant la période de mes 25-30 ans, époque de Born To Run à The River, je me suis mis à écouter énormément de country, de folk ou de blues rural, et simultanément je me suis mis à voir beaucoup de films, à lire pas mal de romans : Flannery O'Connor, James Cain, des romans noirs américains... C'est en macérant là-dedans que j'ai écrit l'album Nebraska. Les films que j'aimais étaient des choses comme Badlands de Terence Malick, True Confessions d'Ulu Grosbard, avec De Niro... ou alors des classiques plus anciens comme La Nuit du chasseur, La Griffe du passé, selon moi l'un des plus beaux films noirs de tous les temps... Ces films avaient en commun un certain rythme narratif plutôt lent, hypnotique. A l'époque, j'ai été très attiré par ce type d'atmosphère et de tempo, mais aussi par les personnages hantés de ces films : je trouve qu'ils avaient quelque chose de fondamentalement américain, peut-être lié à leur solitude, à leur liberté, à leur destinée pleine de promesses et d'échecs. Mitchum dans La Griffe du passé était le symbole ultime de ce genre de personnage. Et je me suis intéressé à ce qui, en moi, ressemblait à ces personnages, à ce qui me connectait si fortement à eux. Je me suis demandé "Pourquoi j'aime tellement ces films, pourquoi je m'identifie à ce point à ces personnages ?" C'était un long travail d'introspection que je pense avoir commencé dans Darkness On The Edge Of Town, que j'ai poursuivi dans The River et que j'ai mené à fond dans Nebraska. Voilà un disque fondamentalement américain, même si cette américanité est parfois difficile à expliquer.
Beaucoup de vos chansons sont comme des petits films. Pratiquez-vous consciemment cette écriture très visuelle, cinématographique ?
Depuis cette période que je viens d'évoquer, les films m'ont influencé très profondément et j'écris volontairement dans un style très cinématographique, notamment en insérant des détails précis dans mes histoires, de façon à faciliter la visualisation mentale. Quand quelqu'un écoute une de mes chansons, il apprend beaucoup d'éléments sur l'histoire que je raconte : sa géographie, son paysage, comment ces lieux se relient à la personnalité du personnage, à ce qui va lui arriver... Le personnage, on connaît ses gestes, on le ressent physiquement... Je donne de nombreux détails qui permettent d'entrer à l'intérieur du personnage. Par exemple, dans The Line, je précise que le flic "repasse son uniforme"... Ce sont tous ces détails accumulés qui font exister un personnage, qui animent et peuplent une chanson. J'essayais aussi de prolonger un certain langage américain à base d'expressions, de tournures idiomatiques... Mes personnages sont devenus très laconiques, ne parlent pas beaucoup, ne s'auto-analysent pas contrairement à moi (rires)... Ils prononcent quelques mots, puis un silence. Et ce qu'ils veulent exprimer est essentiellement contenu dans ces silences. Ce genre de personnage est au centre des chansons de Nebraska, de Tom Joad, de quelques-unes de The River. Mais tout cela concerne les textes. Pour ce qui est du son, à partir de The River, j'étais influencé par tous ces disques roots de Leadbelly, Woody Guthrie, Johnny Cash...
La relation entre les films et vos disques circule parfois dans l'autre sens : Highway Patrolman a ainsi servi de point de départ à Indian Runner de Sean Penn.
J'aime beaucoup le film de Sean. Il a fait ce que tout bon cinéaste doit faire, il m'a un peu "trahi". Il raconte mon histoire, mais il raconte aussi la sienne. Sean a un style assez brut, une rudesse à laquelle on n'est plus tellement habitué dans le cinéma américain contemporain. Il me rappelle l'époque des années 70, quand des films comme Taxi Driver faisaient les gros succès du box-office... Quand on y pense, c'est difficile à croire aujourd'hui : Scorsese était le mainstream, et les blockbusters ressemblaient à Taxi Driver ! Sean est l'un des rares cinéastes d'aujourd'hui qui me renvoient à cette belle époque du cinéma américain, celle des Scorsese, De Palma, Schrader...
Trouvez-vous votre compte dans le cinéma hollywoodien contemporain, basé essentiellement sur les effets spéciaux ?
Oh, ces films ne sont que le dernier avatar de la vieille tradition du cinéma de distraction du samedi après-midi, les descendants des monster movies de mon enfance. Je n'ai pas de grief particulier contre ce cinéma pop-corn. Ce qui me gêne, c'est quand ce cinéma-là étouffe tout le reste. J'apprécie encore l'idée d'aller voir un film de dinosaures le samedi soir, comme j'allais voir mes monster movies. La différence, quand même, c'est que les monster movies avaient des budgets d'environ 1 000 dollars alors qu'un Jurassic Park coûte 100 millions ou plus. Le problème, avec ces gros budgets et ces grosses machines, et aux États-Unis ça vaut pour le cinéma et tout le reste, c'est qu'ils font un tel tintamarre, ils bénéficient de telles campagnes promotionnelles qu'ils finissent par occuper toute la place et éjecter le reste. Et souvent, il n'y a pas de salle à des kilomètres pour présenter d'autres types de films qui sont souvent excellents. On a affaire là à l'un des plus gros vices du système marchand : la course au numéro un, être le premier, battre les records de recettes, etc. Tout ça devient comme une gigantesque course de chevaux. Pour voir un film étranger ou un premier film, il faut être bien au courant, lire la presse, repérer les critiques : c'est disponible, mais réservé à un certain public. Dernièrement, j'ai vu un petit film formidable avec Tim Roth... Little Odessa. Mais il fallait vraiment être à l'affût pour ne pas le louper.
L'un de vos films de chevet est un autre John Ford, La Prisonnière du désert. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans ce film ?
C'est l'histoire d'un homme qui est capable de transformer la communauté dans laquelle il vit. Le personnage joué par John Wayne essaie de reconstituer la communauté qui a été disloquée le jour du kidnapping de la petite fille par les Indiens. John Wayne peut reconstituer cette famille mais ne peut pas la rejoindre. Voilà ce qui résonne en moi : l'histoire d'un type qui peut avoir un impact sur sa communauté, mais ne peut pas l'intégrer. Le dernier plan du film est fabuleux : le vent du désert souffle, John Wayne est debout dans l'encadrement de la porte ; chacun entre dans la maison, chaque membre de la famille franchit le seuil un par un, sauf John Wayne ! Il n'arrive pas à franchir cette porte et retourne au désert. Ce film a eu un impact énorme sur moi. Je crois que cette fin symbolisait ce que je ressentais par rapport à mon activité et à mon existence pendant longtemps. Je faisais un travail qui touchait et affectait la vie des gens, mais je n'arrivais pas à vivre pour moi: pas de port d'attache, pas de compagne régulière, pas de famille, toujours sur la route, etc. C'est cette sensation qui m'a fait m'identifier si intensément au film. Je continue à le revoir régulièrement. En plus, par rapport à la norme du héros hollywoodien, le personnage de John Wayne était complexe et ambigu : raciste, plein de ressentiment, c'était plutôt un anti-héros. Il n'était pas sympathique mais authentique, plus proche de la réalité que du mythe.
Il y a des points communs entre votre travail et celui de Ford. Ressentez-vous ces affinités électives ?
Il essayait de s'en tenir à un ensemble de valeurs. On pouvait ensuite être d'accord ou pas, mais il avait une éthique de vie et la projetait dans ses films. On pouvait estimer que ces valeurs fordiennes étaient parfois trop rigides, trop désuètes, mais il a aussi beaucoup innové. Il a mythifié l'Ouest, notamment en utilisant Monument Valley, et ce mythe a été si puissant, qu'au goût de certains, il a trop camouflé la vraie histoire. Je comprends toutes ces critiques mais, en même temps, il a fait des films splendides qui véhiculaient des émotions très puissantes et très profondes, et certaines de ses valeurs sont toujours pertinentes : la droiture, la simplicité, l'aspiration à une communauté harmonieuse.
Quand j'étais gamin, j'allais aux séances du samedi après-midi. La plupart du temps, on passait des monster movies pour 35 cents... Pendant la période de mes 25-30 ans, époque de Born To Run à The River, je me suis mis à écouter énormément de country, de folk ou de blues rural, et simultanément je me suis mis à voir beaucoup de films, à lire pas mal de romans : Flannery O'Connor, James Cain, des romans noirs américains... C'est en macérant là-dedans que j'ai écrit l'album Nebraska. Les films que j'aimais étaient des choses comme Badlands de Terence Malick, True Confessions d'Ulu Grosbard, avec De Niro... ou alors des classiques plus anciens comme La Nuit du chasseur, La Griffe du passé, selon moi l'un des plus beaux films noirs de tous les temps... Ces films avaient en commun un certain rythme narratif plutôt lent, hypnotique. A l'époque, j'ai été très attiré par ce type d'atmosphère et de tempo, mais aussi par les personnages hantés de ces films : je trouve qu'ils avaient quelque chose de fondamentalement américain, peut-être lié à leur solitude, à leur liberté, à leur destinée pleine de promesses et d'échecs. Mitchum dans La Griffe du passé était le symbole ultime de ce genre de personnage. Et je me suis intéressé à ce qui, en moi, ressemblait à ces personnages, à ce qui me connectait si fortement à eux. Je me suis demandé "Pourquoi j'aime tellement ces films, pourquoi je m'identifie à ce point à ces personnages ?" C'était un long travail d'introspection que je pense avoir commencé dans Darkness On The Edge Of Town, que j'ai poursuivi dans The River et que j'ai mené à fond dans Nebraska. Voilà un disque fondamentalement américain, même si cette américanité est parfois difficile à expliquer.
Beaucoup de vos chansons sont comme des petits films. Pratiquez-vous consciemment cette écriture très visuelle, cinématographique ?
Depuis cette période que je viens d'évoquer, les films m'ont influencé très profondément et j'écris volontairement dans un style très cinématographique, notamment en insérant des détails précis dans mes histoires, de façon à faciliter la visualisation mentale. Quand quelqu'un écoute une de mes chansons, il apprend beaucoup d'éléments sur l'histoire que je raconte : sa géographie, son paysage, comment ces lieux se relient à la personnalité du personnage, à ce qui va lui arriver... Le personnage, on connaît ses gestes, on le ressent physiquement... Je donne de nombreux détails qui permettent d'entrer à l'intérieur du personnage. Par exemple, dans The Line, je précise que le flic "repasse son uniforme"... Ce sont tous ces détails accumulés qui font exister un personnage, qui animent et peuplent une chanson. J'essayais aussi de prolonger un certain langage américain à base d'expressions, de tournures idiomatiques... Mes personnages sont devenus très laconiques, ne parlent pas beaucoup, ne s'auto-analysent pas contrairement à moi (rires)... Ils prononcent quelques mots, puis un silence. Et ce qu'ils veulent exprimer est essentiellement contenu dans ces silences. Ce genre de personnage est au centre des chansons de Nebraska, de Tom Joad, de quelques-unes de The River. Mais tout cela concerne les textes. Pour ce qui est du son, à partir de The River, j'étais influencé par tous ces disques roots de Leadbelly, Woody Guthrie, Johnny Cash...
La relation entre les films et vos disques circule parfois dans l'autre sens : Highway Patrolman a ainsi servi de point de départ à Indian Runner de Sean Penn.
J'aime beaucoup le film de Sean. Il a fait ce que tout bon cinéaste doit faire, il m'a un peu "trahi". Il raconte mon histoire, mais il raconte aussi la sienne. Sean a un style assez brut, une rudesse à laquelle on n'est plus tellement habitué dans le cinéma américain contemporain. Il me rappelle l'époque des années 70, quand des films comme Taxi Driver faisaient les gros succès du box-office... Quand on y pense, c'est difficile à croire aujourd'hui : Scorsese était le mainstream, et les blockbusters ressemblaient à Taxi Driver ! Sean est l'un des rares cinéastes d'aujourd'hui qui me renvoient à cette belle époque du cinéma américain, celle des Scorsese, De Palma, Schrader...
Trouvez-vous votre compte dans le cinéma hollywoodien contemporain, basé essentiellement sur les effets spéciaux ?
Oh, ces films ne sont que le dernier avatar de la vieille tradition du cinéma de distraction du samedi après-midi, les descendants des monster movies de mon enfance. Je n'ai pas de grief particulier contre ce cinéma pop-corn. Ce qui me gêne, c'est quand ce cinéma-là étouffe tout le reste. J'apprécie encore l'idée d'aller voir un film de dinosaures le samedi soir, comme j'allais voir mes monster movies. La différence, quand même, c'est que les monster movies avaient des budgets d'environ 1 000 dollars alors qu'un Jurassic Park coûte 100 millions ou plus. Le problème, avec ces gros budgets et ces grosses machines, et aux États-Unis ça vaut pour le cinéma et tout le reste, c'est qu'ils font un tel tintamarre, ils bénéficient de telles campagnes promotionnelles qu'ils finissent par occuper toute la place et éjecter le reste. Et souvent, il n'y a pas de salle à des kilomètres pour présenter d'autres types de films qui sont souvent excellents. On a affaire là à l'un des plus gros vices du système marchand : la course au numéro un, être le premier, battre les records de recettes, etc. Tout ça devient comme une gigantesque course de chevaux. Pour voir un film étranger ou un premier film, il faut être bien au courant, lire la presse, repérer les critiques : c'est disponible, mais réservé à un certain public. Dernièrement, j'ai vu un petit film formidable avec Tim Roth... Little Odessa. Mais il fallait vraiment être à l'affût pour ne pas le louper.
L'un de vos films de chevet est un autre John Ford, La Prisonnière du désert. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans ce film ?
C'est l'histoire d'un homme qui est capable de transformer la communauté dans laquelle il vit. Le personnage joué par John Wayne essaie de reconstituer la communauté qui a été disloquée le jour du kidnapping de la petite fille par les Indiens. John Wayne peut reconstituer cette famille mais ne peut pas la rejoindre. Voilà ce qui résonne en moi : l'histoire d'un type qui peut avoir un impact sur sa communauté, mais ne peut pas l'intégrer. Le dernier plan du film est fabuleux : le vent du désert souffle, John Wayne est debout dans l'encadrement de la porte ; chacun entre dans la maison, chaque membre de la famille franchit le seuil un par un, sauf John Wayne ! Il n'arrive pas à franchir cette porte et retourne au désert. Ce film a eu un impact énorme sur moi. Je crois que cette fin symbolisait ce que je ressentais par rapport à mon activité et à mon existence pendant longtemps. Je faisais un travail qui touchait et affectait la vie des gens, mais je n'arrivais pas à vivre pour moi: pas de port d'attache, pas de compagne régulière, pas de famille, toujours sur la route, etc. C'est cette sensation qui m'a fait m'identifier si intensément au film. Je continue à le revoir régulièrement. En plus, par rapport à la norme du héros hollywoodien, le personnage de John Wayne était complexe et ambigu : raciste, plein de ressentiment, c'était plutôt un anti-héros. Il n'était pas sympathique mais authentique, plus proche de la réalité que du mythe.
Il y a des points communs entre votre travail et celui de Ford. Ressentez-vous ces affinités électives ?
Il essayait de s'en tenir à un ensemble de valeurs. On pouvait ensuite être d'accord ou pas, mais il avait une éthique de vie et la projetait dans ses films. On pouvait estimer que ces valeurs fordiennes étaient parfois trop rigides, trop désuètes, mais il a aussi beaucoup innové. Il a mythifié l'Ouest, notamment en utilisant Monument Valley, et ce mythe a été si puissant, qu'au goût de certains, il a trop camouflé la vraie histoire. Je comprends toutes ces critiques mais, en même temps, il a fait des films splendides qui véhiculaient des émotions très puissantes et très profondes, et certaines de ses valeurs sont toujours pertinentes : la droiture, la simplicité, l'aspiration à une communauté harmonieuse.
Vous avez grandi pendant les années 50, dans la croyance au rêve américain. Depuis, vous avez écrit des chansons très désenchantées par rapport à cette idée du rêve. Quelle forme doit-il revêtir aujourd'hui et y croyez-vous encore ?
Cette idée du rêve américain a souvent été simplifiée, réduite à des slogans réducteurs, à des images bibliques : "la Terre Promise, la terre des possibilités, le pays du lait et du miel, etc". Ces croyances sont encore très réelles pour beaucoup de monde. Il y a toujours des milliers de gens qui tentent de passer la frontière chaque année, en quête d'une vie meilleure, c'est toujours une terre des possibles. Moi, à travers mes chansons, j'essayais d'apporter ma propre vision de ce rêve américain. Je réclamais en quelque sorte mon droit d'apporter ma propre contribution à ce que devrait être ce rêve, j'essayais de contribuer à rendre cette terre habitable. J'ai toujours été opposé à une certaine idée monolithique du rêve américain, à une certaine vision unidimensionnelle de l'Amérique, basée essentiellement sur l'argent, la réussite individuelle exclusive, le chauvinisme... Ainsi, j'ai montré différentes facettes de l'Amérique, y compris ses aspects maudits, sa part d'échec. J'ai créé toute une série de personnages qui ne sont pas nécessairement des marginaux, mais simplement des gens ordinaires qui essaient de trouver une société vivable, qui luttent pour s'intégrer dans une communauté, qui cherchent leurs frères et sœurs spirituels, des gens avec qui ils peuvent partager certaines valeurs... Voilà la quête majeure de mes personnages. Alors souvent, ils butent sur des obstacles insurmontables, ils sont entravés par les pièges de l'existence, ils sont confrontés à l'intolérance, aux conditions économiques, etc. J'ai toujours montré les deux aspects : la beauté de la quête, mais aussi sa dureté. La chanson Born In The USA résume bien cela : c'est une chanson emplie de fierté et de désenchantement, l'histoire d'un homme qui n'est plus accepté par sa propre communauté, qui n'arrive plus à trouver sa place dans la société.
Vos chansons sont très ancrées dans la réalité américaine et pourtant elles sont universelles.
Je crois que les problèmes quotidiens rencontrés par mes personnages sont universels : le chômage, la pauvreté, le sentiment d'impasse, les rêves d'une vie meilleure existent dans tous les pays du monde. Quand j'étais à Prague, j'ai lu un essai de Vaclav Havel sur la Tchécoslovaquie, sur une société totalitaire : et pourtant, une grande partie du livre pouvait être transposée aux États-Unis. En fait, le livre est tellement fondé sur des valeurs humaines basiques qu'il peut s'appliquer à tout pays, à toute époque. Je ne peux qu'espérer que ma musique possède ces mêmes qualités d'universalité.
Vous parlez beaucoup de l'idée de communauté. Que pensez-vous de l'évolution techno-économique du monde ? L'accélération technologique et les disparités économiques ne détruisent-elles pas le lien social ?
On ne contrôle pas les choses une fois qu'elles existent, on ne contrôle pas le progrès. Mais malgré la technologie, j'ai le sentiment que les gens auront toujours besoin les uns des autres. Le contact humain est irremplaçable. Moi, je ne suis pas un dingue de technologie, je n'ai pas trente-six ordinateurs à la maison. La meilleure chose à faire est de donner à ses enfants une éducation équilibrée, de leur ouvrir l'esprit à divers domaines. Mes enfants savent se servir d'un ordinateur, mais ils aiment aussi lire des livres, regardent la télévision de façon limitée... Si on leur inculque des valeurs équilibrées, ils vivront une vie équilibrée et ne seront pas mangés par les machines. Selon moi, l'enjeu central est là, dans l'éducation. Je n'ai pas d'angoisse particulière quant au futur technologique.
Certains voient une contradiction entre vos préoccupations sociales, vos textes sur les exclus et votre situation sociale et financière. Comment prenez-vous ces critiques qui vous accusent, en gros, de prendre la pose ?
Je trouve ce genre de critique médiocre et paresseuse. Les romanciers écrivent sur le monde qui les entoure ; les cinéastes font des films sur le monde qui les entoure... Scorsese vient de faire un film sur le dalaï-lama et il n'a pas grandi au Tibet, il me semble (rires)... Pas plus qu'il n'était membre de la mafia quand il a fait Mean Streets ou Les Affranchis. Entre parenthèses, il se trouve que moi, je viens de cette classe ouvrière dont je parle dans mes chansons. Mais je crois que là n'est même pas le problème : peu importe d'où vous venez, quel est votre statut social ou votre origine. La seule chose qui compte, c'est de savoir si vous produisez un travail puissant et convaincant. Finalement, le travail d'un artiste finit par avoir une existence autonome, par tenir debout tout seul. Les gens aimeraient croire que les artistes sont absolument identiques aux personnages de leurs œuvres, ils pensent par exemple que Robert De Niro a grandi dans les quartiers populaires de New York. Eh bien non : son père était un artiste, il a vécu dans un environnement intellectuel et cultivé et ça ne l'a pas empêché d'incarner remarquablement des personnages de la rue. J'écris sur le monde dans lequel je vis, sur mes expériences, sur ce que je vois autour de moi, sur des sujets qui me touchent et dans lesquels je me sens à l'aise. Quand vous écoutez tel disque, quand vous lisez tel livre, quand vous voyez tel film, les questions importantes sont "Est-ce sincère ? Y a-t-il une vérité là-dedans ? Est-ce que ça me parle ? Est-ce que c'est fort ? Est-ce que c'est beau ?" Et si les réponses à ces questions sont positives, l'œuvre existe par elle-même.
Cette idée du rêve américain a souvent été simplifiée, réduite à des slogans réducteurs, à des images bibliques : "la Terre Promise, la terre des possibilités, le pays du lait et du miel, etc". Ces croyances sont encore très réelles pour beaucoup de monde. Il y a toujours des milliers de gens qui tentent de passer la frontière chaque année, en quête d'une vie meilleure, c'est toujours une terre des possibles. Moi, à travers mes chansons, j'essayais d'apporter ma propre vision de ce rêve américain. Je réclamais en quelque sorte mon droit d'apporter ma propre contribution à ce que devrait être ce rêve, j'essayais de contribuer à rendre cette terre habitable. J'ai toujours été opposé à une certaine idée monolithique du rêve américain, à une certaine vision unidimensionnelle de l'Amérique, basée essentiellement sur l'argent, la réussite individuelle exclusive, le chauvinisme... Ainsi, j'ai montré différentes facettes de l'Amérique, y compris ses aspects maudits, sa part d'échec. J'ai créé toute une série de personnages qui ne sont pas nécessairement des marginaux, mais simplement des gens ordinaires qui essaient de trouver une société vivable, qui luttent pour s'intégrer dans une communauté, qui cherchent leurs frères et sœurs spirituels, des gens avec qui ils peuvent partager certaines valeurs... Voilà la quête majeure de mes personnages. Alors souvent, ils butent sur des obstacles insurmontables, ils sont entravés par les pièges de l'existence, ils sont confrontés à l'intolérance, aux conditions économiques, etc. J'ai toujours montré les deux aspects : la beauté de la quête, mais aussi sa dureté. La chanson Born In The USA résume bien cela : c'est une chanson emplie de fierté et de désenchantement, l'histoire d'un homme qui n'est plus accepté par sa propre communauté, qui n'arrive plus à trouver sa place dans la société.
Vos chansons sont très ancrées dans la réalité américaine et pourtant elles sont universelles.
Je crois que les problèmes quotidiens rencontrés par mes personnages sont universels : le chômage, la pauvreté, le sentiment d'impasse, les rêves d'une vie meilleure existent dans tous les pays du monde. Quand j'étais à Prague, j'ai lu un essai de Vaclav Havel sur la Tchécoslovaquie, sur une société totalitaire : et pourtant, une grande partie du livre pouvait être transposée aux États-Unis. En fait, le livre est tellement fondé sur des valeurs humaines basiques qu'il peut s'appliquer à tout pays, à toute époque. Je ne peux qu'espérer que ma musique possède ces mêmes qualités d'universalité.
Vous parlez beaucoup de l'idée de communauté. Que pensez-vous de l'évolution techno-économique du monde ? L'accélération technologique et les disparités économiques ne détruisent-elles pas le lien social ?
On ne contrôle pas les choses une fois qu'elles existent, on ne contrôle pas le progrès. Mais malgré la technologie, j'ai le sentiment que les gens auront toujours besoin les uns des autres. Le contact humain est irremplaçable. Moi, je ne suis pas un dingue de technologie, je n'ai pas trente-six ordinateurs à la maison. La meilleure chose à faire est de donner à ses enfants une éducation équilibrée, de leur ouvrir l'esprit à divers domaines. Mes enfants savent se servir d'un ordinateur, mais ils aiment aussi lire des livres, regardent la télévision de façon limitée... Si on leur inculque des valeurs équilibrées, ils vivront une vie équilibrée et ne seront pas mangés par les machines. Selon moi, l'enjeu central est là, dans l'éducation. Je n'ai pas d'angoisse particulière quant au futur technologique.
Certains voient une contradiction entre vos préoccupations sociales, vos textes sur les exclus et votre situation sociale et financière. Comment prenez-vous ces critiques qui vous accusent, en gros, de prendre la pose ?
Je trouve ce genre de critique médiocre et paresseuse. Les romanciers écrivent sur le monde qui les entoure ; les cinéastes font des films sur le monde qui les entoure... Scorsese vient de faire un film sur le dalaï-lama et il n'a pas grandi au Tibet, il me semble (rires)... Pas plus qu'il n'était membre de la mafia quand il a fait Mean Streets ou Les Affranchis. Entre parenthèses, il se trouve que moi, je viens de cette classe ouvrière dont je parle dans mes chansons. Mais je crois que là n'est même pas le problème : peu importe d'où vous venez, quel est votre statut social ou votre origine. La seule chose qui compte, c'est de savoir si vous produisez un travail puissant et convaincant. Finalement, le travail d'un artiste finit par avoir une existence autonome, par tenir debout tout seul. Les gens aimeraient croire que les artistes sont absolument identiques aux personnages de leurs œuvres, ils pensent par exemple que Robert De Niro a grandi dans les quartiers populaires de New York. Eh bien non : son père était un artiste, il a vécu dans un environnement intellectuel et cultivé et ça ne l'a pas empêché d'incarner remarquablement des personnages de la rue. J'écris sur le monde dans lequel je vis, sur mes expériences, sur ce que je vois autour de moi, sur des sujets qui me touchent et dans lesquels je me sens à l'aise. Quand vous écoutez tel disque, quand vous lisez tel livre, quand vous voyez tel film, les questions importantes sont "Est-ce sincère ? Y a-t-il une vérité là-dedans ? Est-ce que ça me parle ? Est-ce que c'est fort ? Est-ce que c'est beau ?" Et si les réponses à ces questions sont positives, l'œuvre existe par elle-même.



 Secret Garden
Secret Garden


















